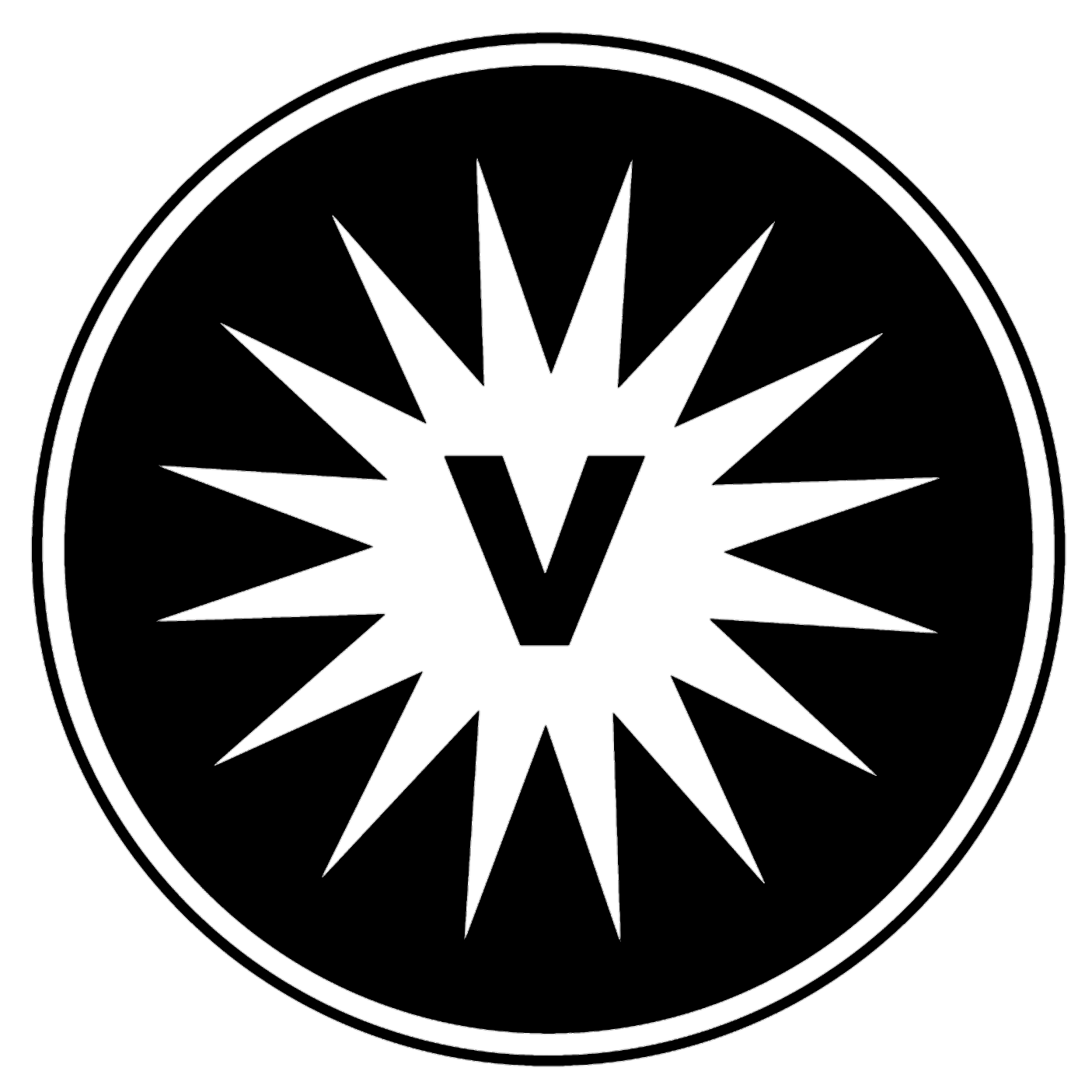Vertige du miroir, abîme du moi, pour David Boulanger par Frédéric Jonnet
Vertige du miroir, abîme du moi,
Pour David Boulanger.
Une approche rapide le classerait sans doute parmi les peintres de la nouvelle figuration. Mais parler de réalisme en ce qui le concerne, c’est comme ne rien dire.
Si on se contente du plus immédiat, du plus ostensible, on a là un art de la référence, de la citation, du filigrane : Van Eyck, Vinci, Manfredi, Vélasquez, Courbet, Monet, Van Gogh, Mondrian, d’autres sans doute, avec une mention spéciale pour Caravage, source directe d’une bonne dizaine d’œuvres. C’est toute l’histoire de la peinture occidentale qui défile sous nos yeux, balisée par une série de chefs d’œuvre « incontournables », presque des clichés pour touriste pressé : La Joconde, L’Homme au chaperon bleu, Impression soleil levant…
Si l’allusion n’est pas encore assez claire, les titres viennent nous aider, si transparents dans leur contrariété ironique qu’ils fonctionnent comme une devinette : ainsi, Impression, soleil levant devient Impression, soleil couchant. Si on s’en tient aux exemples inspirés du Caravage, le Garçon mordu par un lézard devient le Garçon mordu par rien ; le Petit Bacchus malade, Petit Bacchus guéri ; le David triomphant, Goliath vainqueur ; tandis que Salomé recevant la tête du Baptiste se transforme en Saint Jean-Baptiste vainqueur. D’autres titres sont encore plus élémentaires à déchiffrer : Le Chapeau bleu à l’homme, Le Turban rouge à l’homme, La Ceinture de cuir à l’homme…
Bien sûr il faut faire la part de la dérision dans une telle pratique. Ainsi de ces deux toiles jumelles, Garçon mordu par rien et Garçon très mordu, où on passe « logiquement » de l’une à l’autre par « ablation » des mains, que nous devons donc imaginer avoir été entre temps dévorées par quelque molosse : plaisanterie douteuse d’élève des Beaux Arts en mal d’originalité ? Que dire alors de ces différentes Figure abstraite, qui se plaisent à superposer à un Mondrian réduit au rôle de « papier peint », un motif très concret, torse nu ou simple « sweat-shirt » à capuche, dont les lacets pendent à travers leurs œillets : là encore impertinence, manque de respect voire, dans une certaine mesure, vandalisme ? À moins que cette anatomie en gros plan ou ce vêtement en suspend, privés, l’une de son intégrité (sa tête), l’autre de sa fonction (vêtir), tous deux en quelque sorte vidés de leur substance et de leur raison d’être, en deviennent par là même de pures abstractions…
On a le droit de se sentir agressé d’abord, et c’est évidemment voulu, par ce qui pourrait n’être qu’un brillant canular (si tant est que le choc en art puisse être gratuit !). Y plane sans doute encore l’esprit des Dadas, avec leurs jeux de reniement de l’ordre établi, qu’il soit logique (cadavres exquis) ou figuratif (l’Urinoir de Duchamp, la Tête de taureau de Picasso). D’ailleurs la légende L.H.O.O.Q.I qui sert de titre aux différentes évocations de notre Mona Lisa nationale est une référence directe à l’allographe L.H.O.O.Q. (elle a chaud au cul !) qui intitulait la Joconde à moustache de Duchamp. Resterait à savoir ce que signifie l’irruption du I final : peut-être s’agit-il simplement du I de QI, ce qui serait une grimace supplémentaire pour cette Joconde sans tête !
Alors, clin d’œil malicieux certes, mais aussi, peut-être, défi, exercice de style, de virtuosité même, manière de se mesurer aux maîtres. De fait, l’œuvre de Boulanger pose crûment la question : jusqu’où peut-on aller dans la reproduction en évitant le pastiche pur et simple ? Avouons que la fidélité à Caravage de son Sacrifice d’Isaac, ou sa très sulpicienne Marie-Madeleine au Sépulcre, interpellent. Difficile, devant un aveu de déférence et d’allégeance aussi direct et sincère, de s’en tenir à la thèse de la mystification. L’entreprise semble plutôt tenir de la démythification, de la désacralisation, avec ses trompe-l’œil et ses chausse-trappes, fondant un art, plus élaboré qu’il n’y semble, de la déconstruction, de la perversion, de la transgression, voire de l’inversion, comme dans les titres qui l’expriment.
Une inversion souvent simple mais parfois démultipliée jusqu’au vertige, comme dans le Narcisse, d’après Caravage encore, qui retourne la figure du jeune homme et son reflet par rapport à l’original, donnant à ces quatre motifs jumeaux une symétrie croisée qui n’est pas sans troubler nos repères dans l’espace. Ou comme dans Saint, d’après la Méditation de Saint François du même, où un corps à genoux, sans tête, semble s’adresser à son propre crâne, qu’il tient entre ses mains. Ou enfin dans Saint Jean-Baptiste vainqueur, où Boulanger se limite à la moitié droite du tableau du maître, avec la figure du bourreau tendant à Salomé la tête de sa victime : n’apparaît plus alors qu’un corps athlétique impossible à identifier (est-ce le saint décapité mais debout et triomphant ? Le titre de l’œuvre invite à cette interprétation) brandissant son bras vide en une sorte de salut romain pour le moins incongru.
Ainsi, pour peu qu’on s’attarde, au-delà du jeu sur les mots et les formes, il semble qu’on ait chez notre artiste, comme avec Satie (dont se réclamaient d’ailleurs les surréalistes), une interrogation sur l’être, une quête de l’identité en tant que représentation mais aussi que référent, que celui-ci soit plastique ou ontologique : après tout, Boulanger ne dénature pas tant notre patrimoine de la peinture qu’il ne le défigure, au sens où il lui dénie ce qui le caractérise d’habitude. En témoigne son effacement quasi systématique des visages, postulat d’anonymation mais aussi volonté de s’abstraire de l’expression convenue des traits pour se concentrer sur celle, plus spontanée et donc plus authentique, du mouvement des corps, d’atteindre par là une sorte d’épure propre à la sculpture ou à la danse, et donc, paradoxalement, une certaine qualité d’abstraction. Qu’on ne s’étonne donc pas si les visages, pour peu qu’ils apparaissent, sont chez lui la plupart du temps occultés (L’Homme à la bombe, Portrait de Protogène), figés à l’état de crâne (les différentes Vanités, Champ de têtes, Saint ou Vélasquez), d’une blague de potache (Portrait de Toto) ou… du fessier en gros plan de sa callipyge Voisine !
Loin de venir la contredire, l’art du portrait pousse au contraire cette logique jusqu’à l’absurde, en limitant la représentation aux « à-côté » de la personne : ainsi de la série des Cols blancs, chacun renvoyant à une profession qu’il doit suffire à distinguer (le Marchand d’art, le Trader, l’Avocat, le Journaliste). Du modèle lui-même on ne saura rien de plus : jeune ou vieux, beau ou laid, barbu, chauve, souriant, avec ou sans lunettes… Qu’importe en effet si cela permet de capter l’essentiel ? De ce point de vue on peut dire que pour Boulanger, au sens strict, c’est le costume qui fait l’homme, sans d’ailleurs qu’il pondère ce constat d’une condamnation, comme c’est le cas chez Pascal. Resterait à savoir où réside cet essence de l’être : dans l’Eunuque, torse bedonnant en débardeur, c’est, encore une fois, la tête qui manque !
Une exception toutefois, particulièrement significative, à cette ellipse de la représentation, non de l’humain mais de la personne : l’exercice, quasi obsessionnel chez lui, de l’autoportrait, cette objectivation du moi, cette réification des traits, cette scrutation quasi morbide pouvant dégénérer en schizophrénie et qui rapproche sa démarche (voire, dans une certaine mesure, sa facture, comme cela transparaît dans certains fonds tourmentés des Portrait d’homme) de celle de Van Gogh. Chez l’un comme chez l’autre, aucune complaisance, nul narcissisme dans le regard-scalpel qui dissèque jusqu’à déformer et finit par retirer toute humanité à ce qui devrait en être la substance : ainsi de L’Homme au bleu, bouffi par la proximité du point de vue, comme à travers un judas, ou du Jeune homme à la main levée, dont l’attitude inquiétante rappelle irrésistiblement l’incube dans le Cauchemar de Füssli.
D’ailleurs la rupture n’est qu’apparente entre portraits de l’autre et portraits de soi-même ; un de ces derniers ne s’intitule-t-il pas justement le Métèque, c’est-à-dire l’étranger ? Certains sont amputés de moitié, soit verticalement, soit horizontalement ; sur un autre, les traits du visage se fondent dans un décor tourbillonnant façon Tournesols. Mieux, deux toiles, d’une facture un peu différente il est vrai, servent de liant, deux autoportraits torse nu « avec cheveux », le Géant vert et Autoportrait à la main levée, qui se doublent chacun d’une version… sans tête ! Enfin, le Portrait par soi-même ne propose même plus d’alternative : le peintre pose dans sa blouse maculée de taches de couleur qui l’ont comme éclaboussée jusqu’au col. Mais au-dessus, de nouveau, il n’y a rien : « soleil, cou coupé ».
Or, traditionnellement du moins, le visage, c’est la meurtrière de l’âme, qui à la fois l’éclaire et la protège. S’il n’y a pas d’âme perceptible dans toutes ces figures uniformément renfrognées, pétrifiées, détachées de tout rendu « psychologique », pas plus que dans ces fragments de rien que le peintre n’a fait qu’esquisser, fuyants, du bout de son pinceau, c’est que, dans un cas, le visage nous est « donné à voir », sans plus, dans l’autre, il nous est « donné à imaginer » : pour les deux donc, c’est à nous qu’il revient de dépasser l’apparence pour retrouver, re-connaître, par un effort d’introspection, l’essence de ce qui est présenté, et qui, une fois de plus, n’est autre que l’humain, c’est-à-dire nous-mêmes.
L’humain : tel est en effet le paradoxe de Boulanger, qui semble en fuir sans cesse l’expression sans jamais pouvoir s’en détacher, tournant autour comme de la limaille sur un aimant. L’homme est sa source d’inspiration quasi exclusive et on trouve chez lui assez peu de paysages, quoique pouvant eux aussi se recommander d’illustres références, même si, curieusement, le disciple s’y montre, à l’égard du maître, plus libre, peut-être même plus distant. L’hommage à Monet par exemple ne s’arrête pas à l’Impression, soleil couchant, déjà cité (rappelons que Boulanger lui a consacré une exposition) : les différentes Aiguille d’Étretat renvoient bien sûr à la série que le peintre avait consacrée au site, sa plage et ses falaises, tandis que ses Vague évoquent, quoique dans un style curieusement impressionniste, la fameuse estampe d’Hokusai dont un exemplaire, acquis par Monet, est conservé à Giverny (fascinant jeu de miroirs et d’influences, Boulanger reprenant, mais à la manière de Monet, le thème du Japonais). Enfin, les quelques toiles intitulées Champs de blé avec corbeaux s’inspirent à l’évidence du Champ de blé aux corbeaux de Van Gogh.
Quant aux natures mortes, elles se limitent elles aussi à peu de chose : un monumental Bœuf écorché repris de Rembrandt (lui aussi « perverti » et donc… recousu.) et un Croc de boucher d’inspiration voisine. Même quand il intitule un tableau le Violoncelle, il n’y représente que l’instrumentiste (et vice versa d’ailleurs, comme de juste !). Le seul tableau expressément donné comme « nature morte », c’est, assez cyniquement… un autoportrait, en fait un torse nu, sans tête celui-ci, qui pourrait effectivement rappeler, sinistre évocation, un cadavre suspendu dans un saloir. Certains pourront d’ailleurs ressentir quelque malaise devant ces corps amputés exposés à l’envi, ces membres atrophiés, ces doigts de lépreux, exhibés comme des carcasses sur un étal. À moins qu’ils n’y soient sublimés, comme une certaine charogne par Baudelaire…
Car ce n’est pas là qu’elle réside, cette souffrance qu’on ressent chez lui, dans cette torture physique presque palpable : Boulanger n’est pas Bacon, malgré la violence de la thématique (sacrifice, meurtre, décollation). Ses choix esthétiques peuvent même, a contrario, atténuer l’horreur du motif, par exemple dans Abel et Caïn (le titre lui-même gomme l’idée de meurtre), d’après Manfredi, où l’impossibilité de lire les expressions des belligérants sans visage, combinée à l’absence de l’arme dans la main assassine, réduit le corps à corps funeste à une simple scène de lutte, presque sensuelle. Non, le désarroi du peintre, partout manifeste ou peu s’en faut, est sans doute plus intellectuel, s’exprimant plutôt dans l’impossibilité de saisir la réalité profonde des choses et des êtres. Dès lors l’artiste se situerait, par rapport au corps, dans la même relation d’ingestion / digestion que vis-à-vis de ses illustres aînés, frère du monstrueux Saturne de Goya, qu’on s’étonne d’ailleurs de ne pas trouver dans sa galerie des supplices.
Chez lui ce qui palpite en profondeur ne peut s’enraciner que sur le vide, comme un lierre sur un tronc pourrissant. Voyez le double exemple du Petit Bacchus qui renaît justement quand il s’efface : sur une première toile où l’enfant-dieu nous est présenté comme vraiment malade, son corps nu, sans tête, à peine voilé, impose son bras plié accoudé sur une table. Tous ses attributs traditionnels, grappes de raisin, abricots, couronne végétale, pourtant présents dans le tableau du Caravage qui fait référence, ont disparu. On ne les retrouvera que sur la deuxième toile, quand Bacchus est guéri, alors que son corps lui-même, désormais aboli dans l’ombre, resurgit paradoxalement, y compris la tête, cernés « en creux » par ces symboles de vie auxquels il semble devoir sa rémission… et son existence graphique.
Allons plus loin : avec son Homme à la ceinture de cuir, Courbet peignait un jeune dandy tournant vers le spectateur son regard pensif, appuyé sur un gros livre richement relié, un pouce nonchalamment passé à l’intérieur de son ceinturon. Une fois revisité dans la Ceinture de cuir à l’homme, la focale a changé : le personnage s’est évanoui, du moins en tant que tel, que représentation, que réalité tangible. Restent le livre, à présent abandonné, du moins en apparence, et bien sûr la ceinture, qui devient le thème central et justifie l’inversion des termes du titre.
La figure humaine n’est plus qu’évanescence, avatar, spectre, réduite à ce qui n’est pas elle mais seulement la forme qu’elle habite, à savoir ses vêtements. Pas même une silhouette : une sorte de présence-absence, une évocation inhabitée ou plutôt désincarnée. Là encore, la contradiction n’est qu’apparente avec la prolifération de corps à la présence puissante. Sans s’égarer dans une dialectique du paraître et de l’avoir, il faut admettre que dans les deux cas l’humain n’existe que par la suggestion de son « être-là », qui reste à compléter, à reconstruire : l’essentiel de ce qui le constitue devient du vide, mais un vide plein comme un œuf des références avouées ; certes rejeté dans l’ombre du tableau, mais étrangement présent au travers des intentions qu’il manifeste.
Dès lors, qu’on ne prétende plus que Boulanger est un peintre figuratif : il est même le contraire puisque chez lui l’essentiel du tableau, c’est justement ce qui n’y figure pas. Par l’inquiétude qu’il exprime à travers cette aporie et sous couvert d’un humour volontiers caustique, son art est à l’évidence un existentialisme ; c’est donc aussi, en dépit de certaines apparences, un humanisme.
Frédéric Jonnet, 22 février 2010.
À la fois écrivain, critique et amateur d’art, Frédéric Jonnet est aussi docteur en science politique, proviseur et détaché au ministère de la Défense en tant que chargé de mission.
Actuellement à la galerie Ty Art Show pour une exposition exceptionnelle sur la correspondance de Van Gogh revisitée (Le Télégramme).
Galerie Ty Art Show, 42, place de la Chapelle à La Clarté.